-
 Objectifs
Objectifs
-
 Actions
Actions
-
 Conseils
Conseils
-
 Evènements
Evènements
-
 Créteil
Créteil
-
 Alfortville
Alfortville
-
 Saint Maur des Fossés
Saint Maur des Fossés
-
 Sucy-en-Brie
Sucy-en-Brie
-
 Charenton-le-Pont
Charenton-le-Pont
-
 Maisons-Alfort
Maisons-Alfort
-
 Bonneuil-sur-Marne
Bonneuil-sur-Marne
-
 Ivry-sur-Seine
Ivry-sur-Seine
-
 Val de Bièvre
Val de Bièvre
-
 Val-de-Marne
Val-de-Marne
-
 Ile-de-France
Ile-de-France
-
 La Revue de Presse
La Revue de Presse
-
 A propos du site mdb94.org
A propos du site mdb94.org
De la même rubrique
- Où en est le vélo en France - Article du Monde - 12.07.05
- Les deux roues à moteur polluent plus que les voitures - Article du Monde - 30.06.05
- La Pollution Automobile
- Accidents de la route sur 2004
- La Petite Reine
Ce bloc en affiche 5
- Publié le : 13 juillet 2005
- Par : Jean-Paul Grange
- Dernière mise à jour : 23 juin 2009
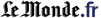 Où en est le vélo en France - Article du Monde - 12.07.05
Où en est le vélo en France - Article du Monde - 12.07.05
Lisez le directement dans le Monde :
l’article
Si vous n’y arrivez pas le voici transmis par Marcel Robert
Point de vue Vive le vélo !
LE MONDE | 12.07.05 | 13h46 • Mis à jour le 12.07.05 | 13h46
On le dit moribond, dépassé ou ringard, et pourtant chaque année le Tour renaît. Ultime repère d’un vieux pays impatient de basculer dans la torpeur estivale. Europe, mondialisation et revendications attendront la rentrée. Le feuilleton du début d’été peut démarrer. Concert d’avertisseurs sonores, tiédeur des étapes de transition ou hystérie des arrivées au sommet, peloton qui s’étire sur fond de champs de blé et vaches hypnotisées, serpentin multicolore sur les pentes encombrées de camping-cars et familles qui saucissonnent.
Le Yankee peut bien écraser l’épreuve. La caravane redémarre et nous allons vivre quelques jours sous l’empire de la petite reine vibrant aux exploits des forçats de la route. Bornage symbolique du territoire et identité en mouvement d’un monument national.
Autant le Tour appartient à notre patrimoine, autant le vélo, son héros définitif, a quitté depuis longtemps son statut d’outil quotidien pour se réfugier dans le mythe sportif ou la pratique dominicale. La communion cathodique annuelle est sans effet sur l’usage quotidien. Les photos jaunies d’ouvriers à bicyclette à la sortie de l’usine appartiennent résolument au passé. Malgré les discours, la place du vélo dans la ville n’a cessé de décroître.
Dans le reste de l’Europe, à Fribourg ou Munster par exemple, un tiers des déplacements se font déjà à deux-roues. Allemands, Néerlandais, Finlandais ou Danois n’hésitent pas à enfourcher leur bicyclette. La petite reine, mode de transport à part entière, règne sur ces villes.
La Deutsche Bahn, par exemple, a compris que la ville se vivait à des vitesses différentes et que la performance d’un parcours urbain ou interurbain dépendait des articulations fluides entre des modes de courtes, moyennes et longues portées, des modes individuels et collectifs. Le client de l’opérateur ferroviaire allemand qui peut utiliser son téléphone mobile pour les transactions accède à une offre complète de vélos, de voitures en partage, de bus, de trains locaux et grandes lignes et de parkings.
En France, le vélo reste en retrait. Son image même est confuse, segmentée. Il y a bien sûr la pratique sportive et conviviale au grand air, façon week-end en VTT entre copains, sorties cyclotouristes avec tenue multicolore obligatoire, balades en famille à l’île de Ré, ou défilé bobo de vélos slalomant entre vide-greniers et marchés bio... Mais il y a aussi les difficultés de l’usage quotidien.
Chaque lundi, pour l’automobiliste coincé dans les bouchons ou le piéton bousculé, le cycliste devient la cible des sarcasmes et des quolibets. Si en retour les rebelles funambules, obligés de relancer la machine à chaque feu, multiplient les bras d’honneur avec l’assurance d’une certaine impunité, c’est aussi pour exprimer leur colère face à une ville inhospitalière. De "fête du vélo" en "journée sans voiture", de célébration en dénonciation, les intentions s’affichent, les coupables sont désignés mais la pratique patine faute de continuités.
Contrairement à nos voisins, nous n’avons pas encore été capables de favoriser l’usage quotidien du vélo et d’en faire un outil de pacification des villes. Il y a vingt ans à Rennes, plus de 10 % des déplacements se faisaient encore à deux-roues. Depuis, cette part a chuté de 7 points. Paris décolle péniblement avec 1 % de part de déplacements malgré promesses tonitruantes, "voies vertes" et autres "espaces civilisés". On perçoit pourtant un léger frémissement.
Un des projets les plus spectaculaires est sans doute l’opération "La Loire à vélo", qui associe les régions Centre et Pays de la Loire et la SNCF pour parcourir 150 kilomètres jalonnés par les villes de Tours et d’Angers, avant bientôt de rejoindre d’autres pistes du côté du Danube : véloroutes européennes. Les collectivités ont développé les pistes, déployé les stations et fédéré les loueurs : on peut récupérer l’engin à un endroit et le déposer à un autre. Service et continuité.
Autre signe encourageant : le succès du nouveau parc public de Lyon, imaginé et géré par Jean-Claude Decaux. Carte bancaire ou carte d’abonnement aux transports publics permettent de déverrouiller les cycles à la station et de les déposer plus loin. C’est la continuité de l’offre associée à des tarifs privilégiés qui convainc. Ce n’est pas le vélo contre les autres modes, mais le vélo maillon d’une chaîne de mobilité.
Au moment où les autorités cherchent à réduire la place de la voiture dans les centres, certaines villes, Bordeaux ou Montpellier par exemple, affichent déjà près de 30 % des déplacements à vélo. D’autres comme Marseille projettent l’implantation de parcs autour de l’idée de transport individuel public.
De son côté, la RATP, qui déploie un réseau Roue libre sur l’agglomération parisienne, ouvre des perspectives fécondes
Avec un prix du baril multiplié par trois en dix-huit mois, le vélo a l’occasion de changer d’image et de stature. Sa mutation dépend de trois conditions : la continuité, la continuité et encore la continuité. Alors seulement l’usager de la ville obtiendra une extension du domaine de sa mobilité.
Cette continuité est d’abord spatiale. La fluidité impose un réseau continu de pistes cyclables, de parcs de stationnement sécurisés à différentes échelles et de connexions avec les parkings et les plates-formes de transports urbains et interurbains. Grâce à ce maillage, des villes comme Strasbourg taquinent déjà les taux d’usage du vélo des villes nordiques (entre 7 % et 10 % des transports interurbains).
Les premières vélostations à Lille, Chambéry ou Clermont-Ferrand autorisent ces parcours. Mais la continuité est également tarifaire. C’est pourquoi des opérateurs de parkings et des municipalités proposent des tarifs intégrés "parking + vélo" qui n’excluent pas la voiture.
Mais il faut le savoir, la gouvernance des mobilités passe toujours par un soutien continu des pouvoirs publics, par le développement de nouveaux partenariats public-privé et l’émergence d’une intelligence des mobilités qui intègre les citoyens dans les décisions. La ligne d’arrivée est encore loin.
Objet populaire, le vélo permet de glisser d’une vision techniciste du transport à une approche sensible des mobilités en réintégrant l’usager dans la définition d’une offre adaptée au quotidien. Sous réserve de continuités, le "vieux clou" devenu vitrine technologique, peut passer du statut d’outil individuel de mobilité à celui de transport individuel public, de la propriété privée à l’objet public. Son usage doit basculer de l’acte militant risqué à un usage banalisé et pacifié : la petite reine, nouvel élément du mobilier urbain et outil d’urbanité.
Ces futurs possibles pour le vélo préfigurent sans doute les mobilités souples et partagées de la ville de demain : une ville à la carte accessible et hospitalière. Reste à changer nos pratiques.
Bruno Marzloff est sociologue et fondateur du Groupe Chronos.
Luc Gwiazdzinski, géographe, est professeur associé à l’université technologique de Belfort-Montbéliard et directeur de la Maison du temps et de la mobilité.
par Bruno Marzloff et Luc Gwiazdzinski
Article paru dans l’édition du 13.07.05
2004-2016 © Place au Vélo 94 - Tous droits réservés
Dernière mise à jour : mercredi 16 mars 2016

 Agenda
Agenda Qui sommes nous ?
Qui sommes nous ? Nos actions
Nos actions La vélo école
La vélo école